Comment refonder la fraternité dans une société qui se fragmente de manière exponentielle ? C’est la question que pose l’abbé de Tanoüarn dans son dernier et brillant essai qui, à contre-courant des idées reçues et de la désespérance diffuse, ouvre de stimulants horizons.
Campagne de soutien 2025
Ce contenu est gratuit, comme le sont tous nos articles.
Soutenez-nous par un don déductible de l’impôt sur le revenu et permettez-nous de continuer à toucher des millions de lecteurs.
Aleteia: Quelle réflexion est à l’origine de ce livre ?
Guillaume de Tanoüarn : Ce qui guide le philosophe thomiste que j’essaie d’être, c’est la quête du bien commun aujourd’hui. Le bien commun n’est pas une notion rigide qui s’épanouirait dans le ciel empyrée des idées, c’est une finalité concrète dont la réalisation n’est pas facultative. La question est beaucoup plus difficile à résoudre dans nos sociétés individualistes que dans des civilisations holistes. Je suis convaincu que l’on ne reviendra pas à un modèle patriarcal. Nous sommes installés dans l’individualisme et on y est pour longtemps. Est-ce que, dans cette société individualiste, il peut encore y avoir un bien commun réel à cultiver ? Est-ce que ce bien commun peut créer une forme de fraternité ?
Et avez-vous pu identifier un socle sur lequel bâtir cette fraternité ?
Le prix de la fraternité, c’est une forme de foi commune. Je tire cette idée du théologien Cajétan selon lequel il existe en chacun d’entre nous une foi innée et commune à tous. Il s’appuie sur les deux premiers chapitres de l’épître de saint Paul aux Romains, et sur le verset 9 du prologue de l’évangile de saint Jean : “Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde”. C’est d’une manière innée que la foi se découvre dans l’homme avant toute prédication. Et la prédication n’est au fond, pour celui qui l’entend et qui est bien disposé, que l’écho de quelque chose qu’il porte en lui. Mon expérience pastorale me fait toucher cette réalité tous les jours.
Cette foi commune, le prêtre que vous êtes la définit comme “non confessionnelle” ?
Parce que l’Église n’est plus ce qu’elle était. Elle fut le temple de la définition des devoirs. Elle n’est plus aujourd’hui que le signe dressé à la face des nations d’une unité qui semble perdue. Il reste pourtant une trace de la civilisation chrétienne, c’est le service. L’acte du colonel Beltrame m’a éclairé : j’y ai vu la puissance de l’exemple dans l’ordre du service. Il s’est mis au service d’une femme dont il a sauvé la vie et son geste a été compris par l’ensemble des Français. Je vois là la preuve que la vieille idée de service n’est pas morte. Si les syndicats défendent le service public, c’est encore pour de vieilles raisons chrétiennes inconscientes, mais fortes !
Ne craignez-vous pas de choquer les chrétiens qui vous lisent en prenant acte de ce déclin ?
Il est très important que le chrétien comprenne quelle est sa foi. Plus qu’autrefois. Aujourd’hui, sous le poids des remises en causes imposées par le monde “lumineux” dans lequel nous vivons, la foi est malade et chacun doit se faire sa propre foi. Une foi purement héritée, cela n’existe plus. Le chrétien, doit savoir qu’il existe une dimension naturelle et une dimension surnaturelle dans la foi. La dimension naturelle me fait le frère de tous les hommes. La dimension surnaturelle me fait le fils de Dieu. Mais je reconnais que cette distinction n’est pas très à la mode en théologie aujourd’hui !
Peut-on tracer le contour de cette foi commune ?
On peut appeler cette foi commune de différentes manières. Orwell parlait de décence commune. Les thomistes parlent de loi naturelle. La foi commune, c’est d’abord la croyance au bien. Une émotion pour le bien. Une détestation du mal. C’est une attitude innée, qui ne dépend pas de la culture que nous avons reçue, et qui peut bien sûr évoluer en fonction de notre éducation. Je ne dis pas que je n’aurais pas aimé que cette foi commune soit la foi de l’Église, mais celle-ci n’a plus la force de représenter ce recours universel.
Cette foi commune demeure néanmoins imbibée de valeurs chrétiennes…
Car ces valeurs chrétiennes sont accessibles à tous si l’on accepte de conjurer l’esprit des Lumières, ce rationalisme qui ampute l’homme de cette dimension fondamentale de lui-même qui est la foi. Si nous sortons de l’ère des Lumières, c’est parce que ces Lumières ne fonctionnent plus dans un monde mélangé où il faut trouver quelque chose de plus grand que la raison. C’est ce que dit Michel Houellebecq qui a, sur ce point me semble-t-il, une dimension prophétique. On peut proposer au monde les valeurs chrétiennes parce qu’elles sont universelles, et parmi ces valeurs, le service en priorité.
La tolérance, précisez-vous, est une condition indispensable à l’épanouissement de cette foi commune
Pour Cajétan, la tolérance est une vertu évangélique, enseignée par le Christ dans la parabole du bon grain et de l’ivraie (Mt 13, 24-30) et dans le discours sur la Montagne (Mt 5, 45). Dieu fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc l’homme doit imiter Dieu à cet égard. La tolérance nous est enseignée, nous dit Cajétan, non pas parce que c’est un pis-aller, parce que faute de mieux il faut être tolérant, mais parce que l’irrespect des personnes est une attitude mauvaise.
Pourtant, vous mettez en garde contre le multiculturalisme, promu au nom de la tolérance ?
Le multiculturalisme, c’est le système selon lequel chacun a son propre système de valeurs, son propre langage, ses propres références, son mode de vie, au mépris de ceux à côté desquels il vit. Dans le système multiculturaliste, il faut accepter que nous ne soyons pas tous frères, que nous n’ayons pas tous cette foi commune, ces références communes, cette vie commune, mais que nous vivions les uns à côté des autres dans une espèce d’indifférence continuelle pour les différences. C’est le système au nom duquel il n’est plus nécessaire de décréter la fraternité.
Quelle sera la conséquence ultime de ce mécanisme ?
Si chacun reste attaché à sa culture, on va se retrouver devant des insécurités culturelles qui aboutiront à des tensions de plus en plus fortes, comme le montre une actualité marquée par une violence constante. Si l’on suit l’actualité sur Twitter, un message sur deux est un message de violence physique et morale. C’est la société multiculturelle qui engendre cette violence. Et j’ose croire qu’autre chose est possible. Un véritable vivre-ensemble. Le multiculturalisme parle sans cesse du vivre-ensemble, mais il le met entre parenthèses car il oublie que vivre ensemble, c’est vivre avec.
PMA, GPA, mariage gay… Ces évolutions sociétales menacent-elles la fraternité ?
Dans l’argumentaire des partisans de la PMA et de la GPA, le désir de l’être humain, comme le désir d’enfant chez une femme lesbienne, doit devenir un droit permis par les évolutions technologiques. C’est le comble du rationalisme, c’est-à-dire le calcul d’un bonheur conçu comme la satisfaction de tous les désirs. C’est, en grossissant le trait, le principe de Sade [mon désir me donne le droit] que l’on retrouve dans cette logique consumériste appliquée à ce qu’il y a de plus sacré.
Dans vos pages, vous rendez un bel hommage au pape François. Pourquoi ?
Le pape François porte l’universalité de la mission de l’Église. Ce n’est pas du tout un humanisme vague et sans contour qu’il propose parce qu’il se réfère constamment au problème du mal qui crée l’urgence de se convertir. Il a le génie de porter sur ses épaules, aujourd’hui, la figure de l’universalité chrétienne, c’est-à-dire de la catholicité.
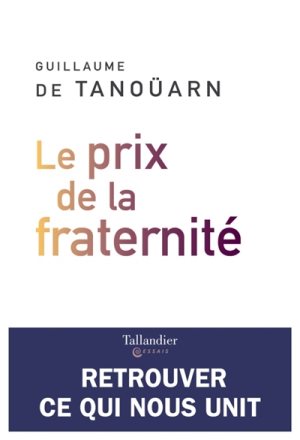
Guillaume de Tanoüarn, Le Prix de la Fraternité, Tallandier, 336 p., 18,90 €.



